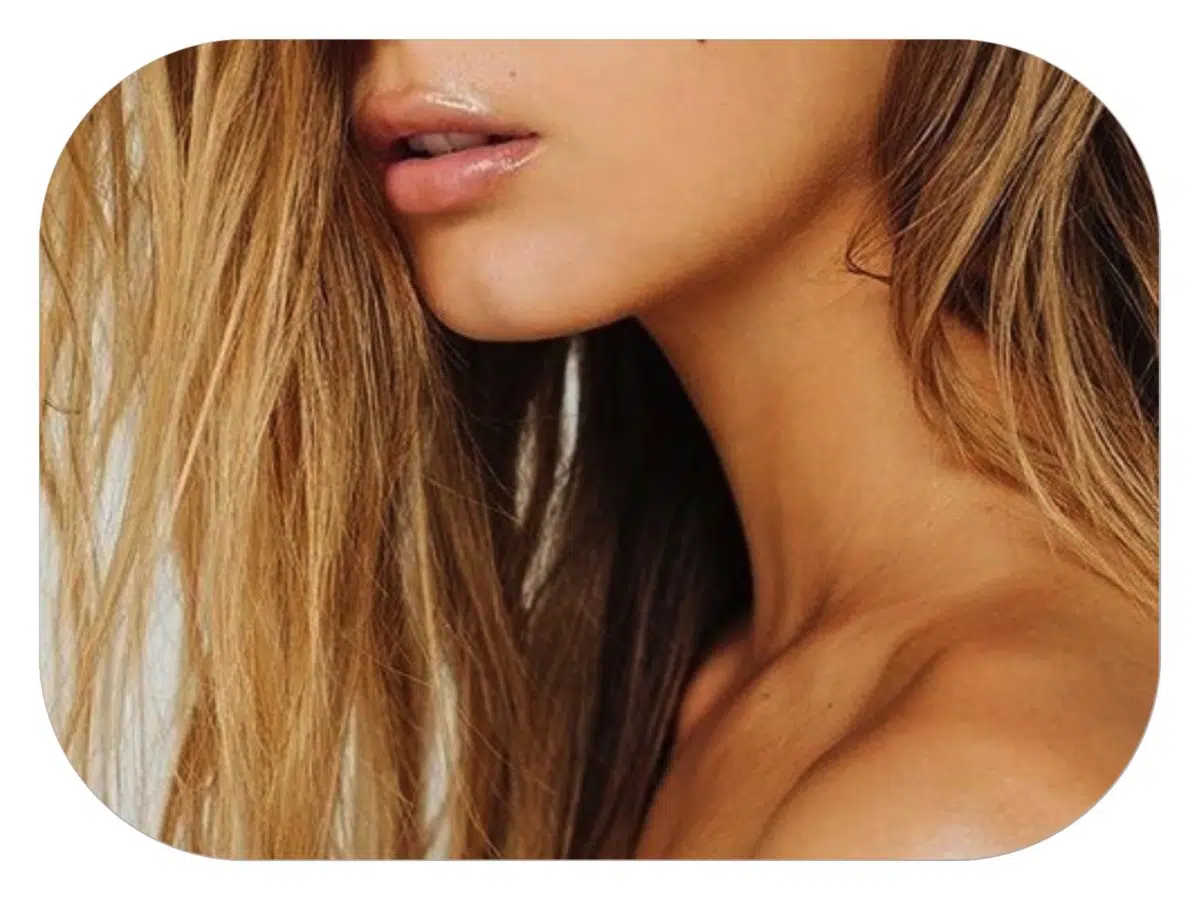En 1910, toute femme respectable de Paris à Londres ne sortait jamais tête nue. L’étiquette fixait des règles strictes sur la forme, la couleur et le moment où porter un chapeau. Certains modèles restaient réservés à la cour, d’autres aux enterrements, d’autres encore aux promenades du dimanche.
Aujourd’hui, la présence du chapeau dans la vie quotidienne s’est réduite à quelques cérémonies et événements mondains. Pourtant, certaines traditions persistent, et des codes sociaux subsistent dans le choix du couvre-chef. Cette évolution soulève de nombreuses interrogations sur le rapport entre mode, société et identité féminine.
Des accessoires de mode à la fois pratiques et symboliques : le rôle des chapeaux dans l’histoire féminine
Le parcours du chapeau féminin suit à la trace les mutations de la société. À l’origine, il s’agit d’un objet pragmatique, un rempart contre la pluie ou les ardeurs du soleil : chapeau de paille dans les marchés du sud, feutre sur les trottoirs parisiens. Mais très vite, le chapeau franchit la frontière de l’utile pour devenir marqueur de distinction sociale et d’identité.
Dès le Moyen Âge, le choix du couvre-chef ne relève pas du caprice : le voile, le bonnet, le chaperon, chacun répond à une règle, à une appartenance. Le temps passe, la silhouette féminine évolue, et le chapeau cloche impose son allure dans le Paris des années folles. Viennent ensuite le chapeau melon, clin d’œil à Chaplin, puis le fedora qui brouille les lignes entre codes masculins et féminins. La mode du XXe siècle emporte tout sur son passage, et Paul Poiret libère la silhouette, le chapeau s’allège et s’affirme.
La fonction du chapeau ne se limite jamais à la parure. Il sert de repère social : la bourgeoise, la modiste, la mariée comme la veuve, chacune porte « son » chapeau, témoin des bouleversements sociaux et culturels qui traversent la France et l’Europe.
Voici les usages les plus emblématiques du chapeau au fil de l’histoire :
- Chapeau de mariage : il incarne la joie collective et l’attachement à un héritage familial ou régional.
- Chapeau religieux : il marque l’adhésion à une communauté, le respect des rites et du regard d’autrui.
- Chapeau de cérémonie : il souligne la solennité d’un événement, voire, parfois, le désir de se démarquer avec panache.
Les créateurs s’emparent du chapeau, l’emmenant sur les podiums, l’habillant d’audace et de nostalgie. Les modèles vintage s’invitent à nouveau dans les collections, le Panama et le chapeau de laine se parent de détails inattendus. Flexible, le chapeau n’a jamais cessé de conjuguer distinction, nécessité et liberté d’inventer son style.
Pourquoi les femmes portaient-elles des chapeaux autrefois ? Entre traditions, codes sociaux et affirmation de soi
Autrefois, la rue se transformait en défilé de silhouettes coiffées, où le chapeau dictait la première impression. Il ne s’agissait pas d’un simple accessoire : la tenue féminine s’articulait autour de lui. Sous Louis XIV, on distinguait d’un regard la bourgeoise de la domestique, la jeune fille de la veuve, grâce à la forme ou la matière de son couvre-chef. Les codes sociaux n’étaient pas négociables : sans chapeau, impossible de franchir la porte d’une église ou de s’afficher dans l’espace public. De la France à l’Angleterre victorienne, la société imposait ses lois du paraître, rigides et universelles.
Le chapeau trouvait aussi ses racines dans la tradition religieuse. À chaque 25 novembre, la fête de la Sainte Catherine imposait aux jeunes femmes célibataires de porter des créations extravagantes. Ce rituel, haut en couleur, permettait d’afficher son statut, tout en jouant avec les regards, les attentes, la curiosité de la société.
Dans les milieux populaires, le chapeau servait d’abri, de protection, parfois même de rempart contre l’adversité. Pour la jeunesse, il devenait terrain d’audace : on choisissait le feutre noir pour afficher son assurance, la paille claire pour évoquer la légèreté. Chaque détail, du ruban à la calotte, permettait de dessiner sa propre voie.
Le chapeau fixait aussi la frontière entre les genres, sans empêcher de timides incursions : Henri III s’autorisait la plume, les femmes la capeline. Même dans l’observance des règles, il subsistait une marge pour affirmer sa personnalité, glisser une note de liberté.
La disparition progressive du chapeau : quelles raisons derrière ce changement de tendance ?
Au début du XXe siècle, le chapeau reste un incontournable de la garde-robe féminine. Mais la Première Guerre mondiale bouleverse la donne : les femmes s’émancipent, investissent l’espace public, conduisent, travaillent. Le chapeau, symbole d’une époque corsetée, devient un obstacle à la praticité. Peu à peu, on l’abandonne. Les cheveux raccourcissent, la mode garçonne supprime les bandeaux et serre-têtes. Avec la Seconde Guerre mondiale, l’utilité prime : la coquetterie du chapeau disparaît au profit de la simplicité. Le couvre-chef, devenu encombrant, quitte la scène du quotidien.
Les décennies suivantes accélèrent ce mouvement : la modernité impose de nouveaux rythmes, la foule des transports, l’urbanisation, la diversité des coiffures. Le chapeau gêne, embarrasse plus qu’il ne valorise. La mode occidentale célèbre désormais la liberté des cheveux, qu’ils soient courts, longs, naturels ou sophistiqués. Les accessoires changent de nature : foulards, casquettes, lunettes de soleil prennent le relais. Les anciens symboles de statut social s’effacent, cédant la place à l’expression individuelle et à la recherche de singularité.
L’évolution du regard sur la femme, portée par les mouvements féministes, accélère cette transformation. Le chapeau, autrefois signe de conformité, finit par être associé à une page tournée : conventions, distinction de genre, vieilles hiérarchies. Des pays comme le Canada, le Royaume-Uni ou la France suivent le même chemin. Le chapeau se fait rare, réservé aux occasions exceptionnelles : mariages, cérémonies, garden-parties. L’accessoire s’adapte, l’époque aussi.
Quand et pourquoi porter un chapeau aujourd’hui ? Les nouvelles occasions et le retour discret de cet accessoire
Désormais, le chapeau opère un retour discret, loin des habitudes du quotidien mais bien présent lors des moments choisis. À Paris, à Nice ou dans les jardins anglais, les chapeaux de mariage et de cérémonie se distinguent par leur raffinement et leur capacité à signer une silhouette. Le chapeau de mode s’affiche lors des Fashion Weeks, propulsé par des créateurs comme Philip Treacy ou Roy Halston, adoptés par Lady Gaga ou Kate Middleton. Sur Instagram ou Pinterest, influenceurs et anonymes réinventent le panama, le fedora ou le chapeau de paille. Ce n’est plus une affaire de nostalgie : c’est une déclaration stylistique, parfois revendicative.
Les nouvelles circonstances du port de chapeau
Voici les situations qui justifient aujourd’hui le choix d’un chapeau :
- Soleil : le chapeau de paille ou de feutre conjugue protection et élégance, parfait pour sublimer une tenue estivale.
- Pluie : le chapeau de laine ou imperméable se révèle un allié pratique, souvent mis à l’honneur dans les pages de Vogue ou Elle.
- Cérémonie : lors d’un mariage, d’une garden-party ou d’une commémoration, le chapeau féminin devient l’élément central d’une tenue codifiée.
Les jeunes générations, inspirées par Audrey Hepburn ou Meghan Markle, réinventent les codes, mêlant vintage et modernité. Dans les villes françaises, le fedora croise le bob, le canotier s’invite à un pique-nique stylé. La mode renouvelle les usages : le chapeau quitte le territoire de la tradition pour revendiquer celui de l’expression personnelle, entre autodérision et affirmation assumée.
Le chapeau ne dicte plus les comportements, il accompagne, suggère, nuance. Les prescriptions sociales d’hier ont disparu, laissant place à la liberté de choisir : un geste, un clin d’œil, une signature silencieuse ou audacieuse. Au fond, le chapeau ne protège plus seulement du soleil, il laisse rayonner la personnalité de celle qui le porte.