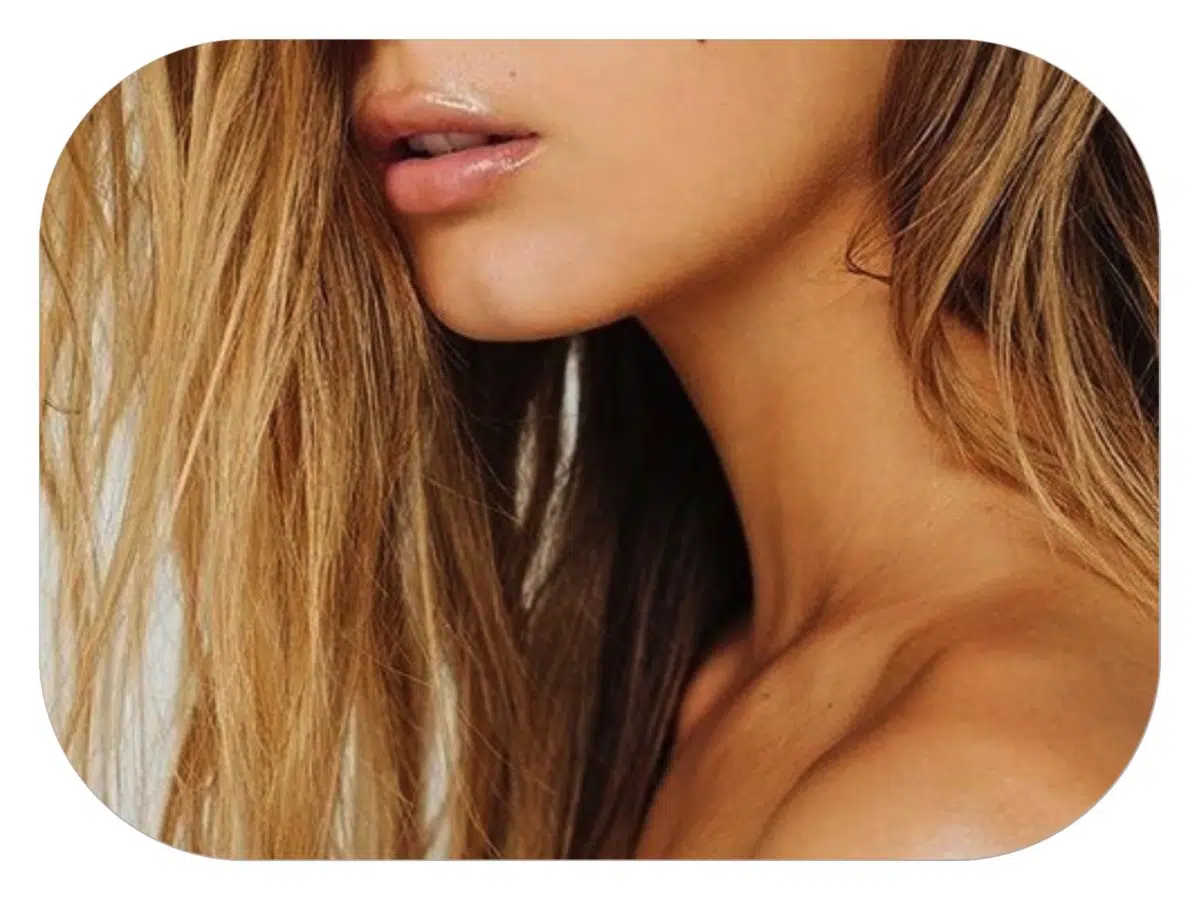Un défilé de mode, c’est la collision de la rigueur et de l’audace, une armée silencieuse qui marche pour dessiner le rêve. À Paris, certains font défiler une poignée d’élues, ailleurs les géants alignent les mannequins comme on aligne les notes d’une symphonie. La collection s’incarne, le regard s’accroche, mais derrière chaque passage, il y a un choix stratégique, un chiffre qui n’a rien d’anodin. Trop peu, et la collection semble inachevée. Trop, et l’ensemble perd son impact. Qui tire les ficelles de ce ballet millimétré ? Le nombre de mannequins, ce n’est jamais juste une affaire de logistique : c’est un enjeu, un message, parfois même une déclaration de guerre feutrée entre maisons rivales.
Le défilé de mode : un spectacle orchestré dans les moindres détails
La Fashion Week à Paris, c’est le tempo de la planète mode. Sept, dix, vingt minutes de spectacle, et chaque seconde compte. À New York, Londres, Milan, Paris, les projecteurs s’allument tour à tour, sous le regard de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, des journalistes de Vogue Business, et d’un public avide de nouveauté. Tout est calculé : décor monumental ou scénographie épurée, chaque détail s’ajuste à la vision du créateur.
Le casting constitue l’ossature du défilé. À chaque saison, les maisons puisent dans des centaines de profils pour choisir qui portera leurs créations. Les chiffres varient, mais l’ambition reste la même : frapper fort, marquer les esprits. À Paris, pour les grandes maisons, la moyenne se situe entre vingt-cinq et quarante mannequins. À Milan ou Londres, on module : quinze, parfois cinquante, selon l’envergure de la collection et la volonté d’impressionner.
- Défilé moyen : 30 mannequins
- Micro-show d’un jeune créateur : 10 à 15 looks
- Déploiement maximal chez les mastodontes : 60 silhouettes
La durée du show file à toute vitesse : rarement plus de dix minutes. Mais chaque instant est millimétré. Le rythme, la succession des looks, la musique : tout s’emboîte avec une rigueur d’horloger. Derrière la scène, l’excitation est palpable, la tension monte, la porte s’ouvre, et soudain, le spectacle s’élance.
Combien de mannequins défilent en moyenne lors d’un show ?
Le nombre, loin d’être arbitraire, répond à une logique précise : raconter une histoire en images, rythmer la collection, captiver le public. En moyenne, un défilé de mode réunit 30 mannequins sur le podium. Les grandes maisons à Paris ou Milan orchestrent entre 25 et 45 passages. Les jeunes créateurs, plus agiles, optent souvent pour 10 à 15 silhouettes pour transmettre une vision percutante. Certaines maisons – Dolce & Gabbana, Christian Dior – atteignent les soixante looks, mais ce format reste l’apanage des géants, pas la norme.
| Type de show | Nombre moyen de mannequins |
|---|---|
| Défilé jeune créateur | 10 à 15 |
| Défilé maison confirmée | 25 à 45 |
| Show d’envergure (maison iconique) | 50 à 60 |
La diversité morphologique sur les podiums reste encore timide. Environ 95 % des mannequins portent une taille 32 à 36. Les profils plus size franchissent à peine 0,9 % des effectifs selon les saisons. Les mannequins mid-size commencent à émerger, mais leur présence est loin d’être généralisée. Malgré quelques efforts, l’image du défilé demeure largement fidèle à un modèle de corps très normé. Quelques créateurs, surtout à Londres ou New York, injectent une dose de diversité pour faire bouger les lignes, mais l’exception ne fait pas encore la règle.
Facteurs qui influencent le nombre de mannequins sur le podium
Choisir le casting d’un défilé, c’est jongler avec une multitude de paramètres. La taille de la collection reste déterminante : douze silhouettes pour une maison émergente, jusqu’à soixante pour un mastodonte comme Dolce & Gabbana. La durée du show s’étire rarement au-delà de vingt minutes, souvent balisée entre sept et vingt selon la Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Le public, lui, ne pardonne pas l’ennui : un show qui s’étire, et l’attention s’évapore.
Les tendances sociétales s’invitent sur le podium, bousculant parfois les codes :
- La vague body positive pousse certaines marques à ouvrir un peu le jeu, sans vraiment bouleverser la donne.
- Les mouvements body neutral et d’inclusivité tentent leur percée, mais la diversité morphologique avance à petits pas.
- Le retour du heroin chic, silhouette longiligne façon années 1990, referme parfois la porte à la pluralité des corps.
Les règles du secteur font aussi la loi. La charte Kering/LVMH interdit les mannequins de moins de seize ans et impose une taille minimale de 34. Victoria’s Secret, longtemps symbole d’un standard inatteignable, a revu sa copie sous la pression médiatique. Gucci et Dior affichent une volonté d’ouverture au mid-size, mais d’après Vogue Business, la proportion de mannequins plus size reste inférieure à 1 %.
La stratégie commerciale guide aussi le curseur. Le modèle « see-now, buy-now », qui mise sur l’achat immédiat après le défilé, privilégie des collections resserrées et des castings plus courts. Les marques cherchent l’impact, la viralité, mais aussi une identité forte, souvent incarnée par quelques visages récurrents, immédiatement reconnaissables.
Entre tradition et innovation : l’évolution du casting des défilés
Saison après saison, le casting des défilés oscille entre inertie et frémissements. Les mannequins skinny dominent toujours la scène, la taille 32 à 36 reste la norme pour plus de 95 % des passages. Pourtant, certains visages dérangent l’ordre établi. Ashley Graham, Paloma Elsesser, Candice Huffine s’imposent sur les catwalks, mais leur présence fait encore figure d’exception. En France, la diversité morphologique avance à pas comptés. Aux États-Unis, moteurs du mouvement plus size, la dynamique est plus affirmée : Ashley Graham défile pour Prabal Gurung, Fenty, Christian Siriano, et ses passages font le tour des réseaux sociaux.
Des créatrices émergentes injectent de la nouveauté. Karoline Vitto, Sinéad O’Dwyer, Ester Manas : ces noms incarnent l’envie de faire exister des silhouettes mid-size et plus size sur scène. À Londres, la scène jeune fait bouger les lignes, poussée par la viralité des réseaux sociaux et une demande d’authenticité croissante.
- Clémentine Desseaux, mannequin franco-américaine, le répète : la diversité s’impose désormais par la force des réseaux sociaux.
- Pourtant, selon Vogue Business, la part des mannequins plus size dépasse rarement le seuil symbolique d’1 % sur les podiums internationaux.
L’ombre de Karl Lagerfeld plane encore : « Personne ne veut voir des femmes rondes sur les podiums. » Cette phrase, reprise à l’envi, incarne la fracture entre héritage et renouveau. Les agences s’adaptent, mais la forteresse ne cède qu’à petites touches. Les jeunes marques, elles, refusent la résignation et réinventent le casting, prouvant qu’il n’est jamais trop tard pour bouleverser la donne.